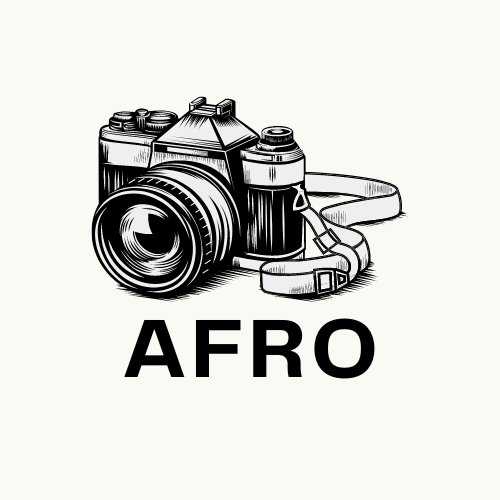La guerre de trois mois : l’intervention française au Mali
devant l’urgence des événements au Mali, la France a rompu avec des années d’hésitations dans l’emploi de la force, pour frapper directement et violemment un ennemi clairement identifié. Contrairement aux idées alors admises, il s’avérait donc que l’action unilatérale était encore possible, dès lors qu’existait une volonté politique permettant d’engager des troupes au sol et de prendre des risques.
2La victoire militaire au Mali, pour brillante qu’elle soit, est cependant encore incomplète et surtout limitée. La France a gagné une bataille. Elle n’a pas pour autant stabilisé le pays ni surtout vaincu le djihadisme au Sahel, et il ne suffira pas de le dire pour faire disparaître nos ennemis. Il reste à faire en sorte que cette guerre de trois mois victorieuse ne soit pas un coup d’épée dans le sable, ce qui suppose
au moins une vision stratégique de la région et le maintien de capacités militaires adaptées.
Une surprise stratégique française
3L’intervention militaire au Mali, le 11 janvier 2013, est d’abord une surprise stratégique pour les djihadistes qui, en lançant la veille leur offensive vers le Sud du Mali, n’avaient probablement pas anticipé la réaction française. Du côté français, les moyens d’intervention aériens et terrestres étaient pourtant visibles et relativement proches, de la Côte-d’Ivoire au Tchad en passant par le Gabon et le Burkina-Faso, sans parler du dispositif d’alerte métropolitain. Très clairement, nos ennemis n’ont pas cru que la France, c’est-à-dire le président de la République, oserait s’en servir.
Cette erreur d’appréciation doit certainement à une vision d’États occidentaux réticents à s’engager vraiment après l’expérience afghano-irakienne, mais aussi de plus en plus empêchés de le faire par un Conseil de sécurité des Nations unies renouant peu à peu avec les grippages de la guerre froide. L’intervention en Libye en 2011, elle-même très indirecte et non suivie d’une opération de stabilisation au sol, a pu apparaître comme le chant du cygne d’une volonté déclinante. Les atermoiements qui ont suivi face à la guerre civile syrienne semblaient confirmer que l’on avait effectivement atteint un point bas.
5Plus localement, et à plus court terme, l’idée qu’aucune puissance extérieure n’interviendrait au Mali pouvait s’appuyer sur un certain nombre de déclarations françaises. Un ancien responsable des opérations des armées françaises n’affirmait-il pas lui-même en juillet 2012 que « les enseignements tirés des opérations en Afghanistan interdisent, de fait, pratiquement toute intervention terrestre menée par les Occidentaux dans un pays musulman [1][1]J.-P. Gaviard, « Intervention militaire en Syrie : quelles…
e – incarnation de la dissuasion française, qu’elle soit nucléaire ou conventionnelle – déclarait en octobre et en novembre 2012 qu’il n’y aurait pas d’intervention directe au Mali mais seulement un appui à une force régionale [2]
lente à se mettre en place et à une armée malienne décomposée, les organisations djihadistes ont pu croire qu’elles bénéficiaient d’une grande liberté d’action pendant quelques mois, liberté dont elles ont voulu profiter. Leur analyse était en partie juste : un point bas avait effectivement été atteint dans la manière de mener des interventions militaires, mais ce point bas était aussi un point d’inflexion.
Le retour au système d’intervention rapide classique français
7L’opération Serval et, dans une moindre mesure, l’aide au président ivoirien Alassane Ouattara en avril 2011 consacrent d’abord le retour à une forme classique d’intervention rapide de la France, proche de celle que l’on connaissait durant la guerre froide. Dans un contexte géopolitique de retrait relatif des États-Unis et de poussée croissante de menaces en Afrique, la France a mené 14 opérations de guerre en Afrique de 1977 à 1980, qui ont toutes été des succès militaires. Ces succès résultaient d’un système
spécifique reposant sur des institutions autorisant un processus de décision rapide, un consensus sur cet emploi « discrétionnaire » des forces, des unités prépositionnées, des éléments en alerte en métropole, des moyens de transport et de frappe à distance, la capacité à fusionner avec des forces locales et la combinaison tactique du combat rapproché au sol et des appuis aériens.
8Ce système permettait aux forces françaises d’éteindre les incendies au plus tôt, sans y consacrer beaucoup de moyens et sans rester sur place outre mesure. L’autorité politique n’étant pas inhibée par les pertes (33 soldats tués en mai-juin 1978 au Tchad et au Zaïre), elle s’immisçait peu dans les opérations. Celles-ci avaient donc de plus fortes chances de succès et, in fine, les pertes restaient limitées puisque la durée des opérations l’était également.
9Les opérations françaises ont commencé à perdre de leur efficacité lorsqu’on est sorti de ce système. De la Force d’interposition des Nations unies au Liban en 1978 à l’opération Licorne débutée en 2002 en République de Côte-d’Ivoire, l’armée française a payé cher l’abandon de la notion d’ennemi. De l’engagement en Bosnie au conflit afghan, elle a découvert les limites des opérations en coalition
lenteurs du processus de décision et de mise en place, disparité des cultures militaires, imposition des méthodes du meneur de la coalition, schizophrénie de ses membres, poursuivant à la fois des objectifs nationaux propres et des objectifs communs. Dans le cas afghan, elle a goûté également à la paralysie par l’intrusion politique.
10La spirale de l’inefficience militaire a finalement atteint son point bas en avril 2012, avec la conquête du Nord-Mali par les indépendantistes touaregs et les djihadistes, puisqu’on a pu y constater simultanément l’échec de l’approche indirecte américaine d’aide aux armées locales [3][3]M. Kandel, « Obama et Bamako : l’implication discrète mais… et la stérilité des solutions militaires régionales. Sans l’offensive djihadiste, et après 15 années de renforcement de capacités africaines de maintien de la paix, il aurait fallu pratiquement une année complète pour faire intervenir l’équivalent d’une brigade légère, ce qui aurait sans doute constitué une des projections de forces les moins dynamiques de l’histoire. Il est vrai que cette projection avait encore été ralentie par la très modeste implication de l’Union européenne (UE), autre faible substitut à l’intervention directe
française depuis la fin des années 1990. Rétrospectivement, on ne peut d’ailleurs que constater l’impuissance dont aurait été frappée cette première MISMA face à la puissance, pourtant connue, des organisations djihadistes.
11Il aura donc ainsi fallu aller jusqu’au bout d’un processus, jusqu’à son blocage final, pour stimuler l’audace de nos ennemis et, au bout du compte, ne laisser d’autre choix que le retour à une forme classique des interventions militaires « à la française ». La clé de voûte du mouvement étant ici une volonté politique claire, assumant d’emblée l’idée de guerre, et sans intrusion tactique. Ce préalable acquis, le reste du système d’intervention a été prompt à se réactiver.
[2]Voir …. La simple absence d’une unité de protection terrestre, comme cela avait été le cas dans le passé dans plusieurs capitales africaines lorsque les ressortissants et les intérêts français avaient été gravement menacés, semblait visiblement témoigner que nous n’étions pas prêts à « mourir pour Bamako ».
6Dans ces conditions, face à une Mission internationale de soutien au Mali (MISMA) particulièrement
» ? Plus important, le président de la Républiqu