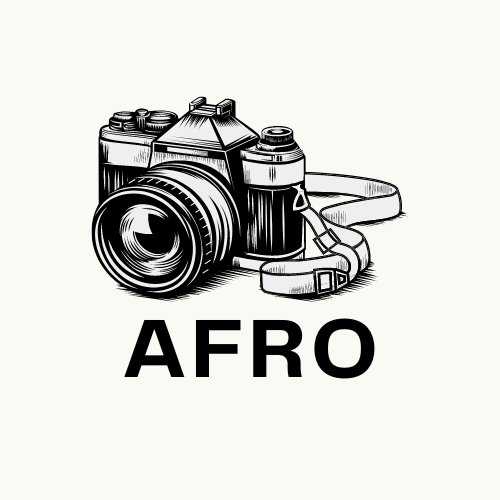En 1914, lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale, les frontières maliennes d’aujourd’hui ne sont pas encore dessinées. Le territoire était intégré dans un grand ensemble appelé le Haut-Sénégal-Niger. Comme dans d’autres colonies françaises, des Africains sont mobilisés pour combattre dans les rangs de l’armée française pendant la Grande Guerre. Aujourd’hui au Mali, tous les anciens combattants ont disparu. Quel souvenir ont gardé les Maliens de la Grande Guerre ?
La guerre du Mali est un conflit armé qui a lieu au Mali depuis 2012, à la suite d’une insurrection de groupes salafistes djihadistes et indépendantistes pro-Azawad.
Ce conflit s’inscrit dans le contexte de la guerre du Sahel et des rébellions touarègues contre l’État malien. Depuis le début des années 1990, le nord du Mali est le théâtre de plusieurs insurrections menées par des rebelles touaregs. Au début des années 2000, des djihadistes algériens viennent également se réfugier clandestinement au Mali après leur défaite lors de la guerre civile algérienne. En 2011, la guerre civile libyenne rallume indirectement le conflit au Mali. Des arsenaux militaires libyens sont pillés par des groupes armés, tandis que des mercenaires touaregs au service de la Jamahiriya arabe libyenne de Kadhafi s’enfuient vers le Sahara et rejoignent des mouvements rebelles avec armes et bagages.
Le , les rebelles touaregs du Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA, indépendantiste) et d’Ansar Dine (salafiste) déclenchent la cinquième rébellion touarègue contre le Mali. Bientôt rejoints par les djihadistes d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et du Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), ils prennent Aguel’hoc, Ménaka et Tessalit. À la suite de ces défaites, une partie de l’armée malienne tente un coup d’État en mars qui provoque des affrontements entre « bérets verts » et « bérets rouges » et désorganise les opérations au Nord. Les rebelles en profitent et s’emparent de Kidal, Tombouctou et Gao. Le , le MNLA annonce la fin de son offensive et proclame l’indépendance de l’Azawad. Les combats ont alors fait des centaines de morts et des centaines de milliers de réfugiés.
Cependant, les divergences idéologiques entre indépendantistes et djihadistes brisent rapidement leur alliance. Entre juin et novembre 2012, les combats tournent au désavantage du MNLA, qui est chassé de Gao, de Tombouctou, de Kidal et de Ménaka. Les djihadistes prennent alors le contrôle de presque tout le nord malien.
Fin 2012, les négociations échouent et en , les djihadistes lancent une offensive sur Ségou et Mopti, dans le centre du Mali. Cette attaque provoque l’entrée en guerre de la France, avec le lancement de l’opération Serval, et de plusieurs pays africains de la CEDEAO dans le cadre de la MISMA. En quelques jours, les islamistes sont repoussés à Konna et Diabaly, puis Gao et Tombouctou sont reprises. Les forces djihadistes en déroute abandonnent les villes, dont certaines comme Kidal sont reprises par le MNLA, et se retranchent dans l’Adrar Tigharghar, situé dans l’Adrar des Ifoghas. En mars, Tigharghar, la principale base djihadiste au Mali, est conquise au terme d’une offensive franco-tchadienne.
De nombreux combattants islamistes désertent, changent de camp ou fuient à l’étranger, d’autres, en revanche, poursuivent la guérilla, posent des mines et mènent des attentats. Des affrontements ponctuels opposent également le gouvernement malien aux indépendantistes, qui refusent la venue de l’armée malienne dans la région de Kidal. Le , après deux semaines de négociations, le gouvernement de transition malien et les rebelles du MNLA, du HCUA et du MAA signent un accord de cessez-le-feu qui permet le retour des autorités maliennes à Kidal et la tenue de l’élection présidentielle le dans le nord du pays.
De son côté, l’ONU prend le relais de la MISMA et met en place la MINUSMA, tandis que l’Union européenne engage la mission de formation de l’Union européenne au Mali.